1291 maternités ont fermé entre 1972 et 2021, entraînant une hausse des inégalités et une dégradation de la santé des femmes. État des lieux.

Dans quelles conditions les femmes du milieu rural et les coparents peuvent-ils développer leur projet d’enfant en sécurité : grossesse, accouchement, petite enfance, en incluant les répercussions de ce projet sur leur sécurité affective et sociale, leur santé, leur emploi et leur habitat ? Un constat s’impose : depuis les années 1970, les services publics se sont retirés d’un espace de vie qui regroupe 88 % des communes, un tiers des Français métropolitains et 11 millions de femmes dont 4 millions dans les zones isolées et moins peuplées. L’offre de soins s’est raréfiée : peu de médecins généralistes, de gynécologues, d’anesthésistes, de centres de santé… Cet abandon a des répercussions graves sur la santé des populations rurales. Plus touchées que les hommes dans les domaines de la santé et de la formation, les femmes portent la charge mentale, physique et financière de ce retirement irresponsable. En ne favorisant pas leurs accès aux soins de proximité basiques, l’état les expose à des violences dans la sphère publique et privée : 50 % des victimes de violences conjugales et 47 % des féminicides concernent les femmes du milieu rural, dont 26 % seulement sollicitent les dispositifs ad hoc.
1291 maternités fermées
Les structures d’accompagnement du projet de naissance se sont délitées : en 46 ans, les pouvoirs publics ont fermé 1 291 maternités. En 1972, 1 747 maternités accueillaient 911 161 accouchements. En 2021, il ne reste plus que 456 maternités pour 740 000 accouchements, soit une perte de 75 % des maternités pour une baisse de 20 % des naissances. La fermeture d’une trentaine de maternités est programmée malgré les mouvements de protestation des petites villes. De plus, la politique budgétaire suivie par l’État empêche les petites maternités de se moderniser : on les ferme donc au nom… de la sécurité.
Éloignement et inégalités
Les maternités de proximité ont été remplacées par des unités de soins intensifs situées dans des agglomé rations, à des distances allant jusqu’à 100 km des bourgs. Cet éloignement et le temps de transport vers les lieux de soins dédiés au suivi de la grossesse, qui exclut d’abord les plus pauvres, est l’inégalité la plus frappante. Deux femmes sur dix n’ont pas de voiture en zone rurale. Entre 2000 et 2017, le nombre de femmes résidant à plus de 30 minutes de route d’une maternité a augmenté d’un tiers. Celui des femmes vivant à plus de 45 km a augmenté de 40 %. La logistique de gestion de la distance repose sur les femmes : car burant, temps contraint, gardes des enfants : la Sécurité sociale ne prend en charge aucun de ces coûts. Péridurale, accélération du travail, surveillance sur écrans : en maternité, l’approche strictement médicale et instrumentale prédomine, occultant la dimension privée, individuelle, porteuse d’autonomie de l’accouchement. Les statistiques officielles sur l’action des services de l’État assimilent la grossesse à un état pathologique. Or, les accouchements relèvent dans 70 % des cas de soins d’accompagnement d’une sage-femme, surtout si elle pratique l’accouchement physiologique où les interventions se limitent au strict nécessaire dans le souci de ne pas perturber le processus de la naissance en cours.
Dégradation de la santé des femmes
Les rapports de la Dress, de l’Ined, de l’Insee, de l’Inserm, de Santé publique France, des parlementaires, du Droit des femmes…. indiquent une dégradation de l’état de santé des femmes qui place la France en queue de peloton de l’Union européenne, notamment pour le taux de prématurité et de diabète gestationnel. Le suivi des fœtus et des nouveau-nés présentant des risques s’est amélioré mais l’état de santé mentale et physique des mères et des nouveau-nés habitant en zone rurale et en zone périurbaine – et surtout celui des femmes pauvres et isolées– interroge : depuis 2015, la mortalité infantile en France est supérieure à la moyenne européenne. En 2021, 2 700 enfants de moins d’un an sont décédés, soit 3,7 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de suicide post-partum est la première cause de décès des mères, avec les maladies cardio-vasculaires. Entre 2013 et 2015 on constate 262 décès maternels.
Des maisons de santé et de naissance
Quelle évolution espérer dans ce contexte dégradé ? Pour les soins de proximité, des tendances émergent. Des communes se regroupent pour créer des « Maisons de santé de village » autour d’un médecin généraliste, de sages-femmes, de kinés, etc. Des sages-femmes et des thérapeutes regroupent leurs cabinets, faisant le choix d’exercer une activité de proximité dans des petites villes. Des associations d’usager·ères animent des lieux de parentalité et des crèches parentales. Pour la naissance, trois propositions d’accouchements alternatifs existent dans l’esprit de l’accouchement physiologique, respectueux des rythmes des femmes : l’accouchement à domicile sans assistance (pas de chiffres), l’accouchement à domicile assisté par des sages femmes libérales (2 000 naissances), qui auraient besoin d’être soutenues plus activement, et, au point médian entre l’hôpital et l’accouchement à domicile, huit maisons de naissance (MDN) assurent 1 000 accouchements par an. Des associations de parents s’attellent à en créer de nouvelles, tandis qu’un mouvement dynamique veille au maintien de l’existant. Pour se rapprocher des MDN ou pour épargner de la route aux sages-femmes à domicile, l’idée est lancée de servir de points-relais en accueillant chez soi pour plusieurs jours une parturiente : à suivre… ● Françoise-Edmonde Morin (Relier)
Projet d’enfant en milieu rural : questionner la norme En 2021, le Réseau d’expérimentation et de liaison des intitiatives en rural (Relier) initiait un travail autour du projet d’enfant en milieu rural, un sujet peu fréquenté, et demandait à ses membres l’intérêt qu’ils portaient au thème. Résultat, des constats subjectifs mais pas de vision claire sur les enjeux de la reproduction humaine et les effets des politiques publiques sur la santé des femmes et des nourrissons : il fallait documenter le sujet par la littérature et l’enquête de terrain. Et, chemin faisant, dénicher les alternatives susceptibles d’améliorer l’existant. En 2022-2023, à partir des lieux habités par les membres de Relier, l’enquête a démarré autour de Limoges, Saint-Affrique, Millau et Castres puis en 2024, en Isère et en Savoie. Des travaux menés sur fonds propres, faute d’avoir pu/su convaincre des fondations de soutenir ce travail. F.B.
- Accéder aux services publics en milieu rural : les femmes en première ligne ? E. Agnoux, E. Nicot. Fondation Jean-Jaurès. 2023.
- Inégalités en milieu rural, Femmes et ruralité. Rapport d’information de la Délégation des femmes au Sénat. 2021.
- L’accès aux services publics dans les territoires ruraux. Cour des Comptes. Mars 2019.
- Enquête nationale périnatale. Les naissances, le suivi à deux mois et les établissements. Rapport 2021. Inserm.
- Suicide en période périnatale : données épidémiologiques récentes et stratégies de prévention. Santé publique France. 2023.
- Mission « Flash » sur la mortalité infantile. Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. 2023.
- Insee Focus n° 301. Juin 2023.
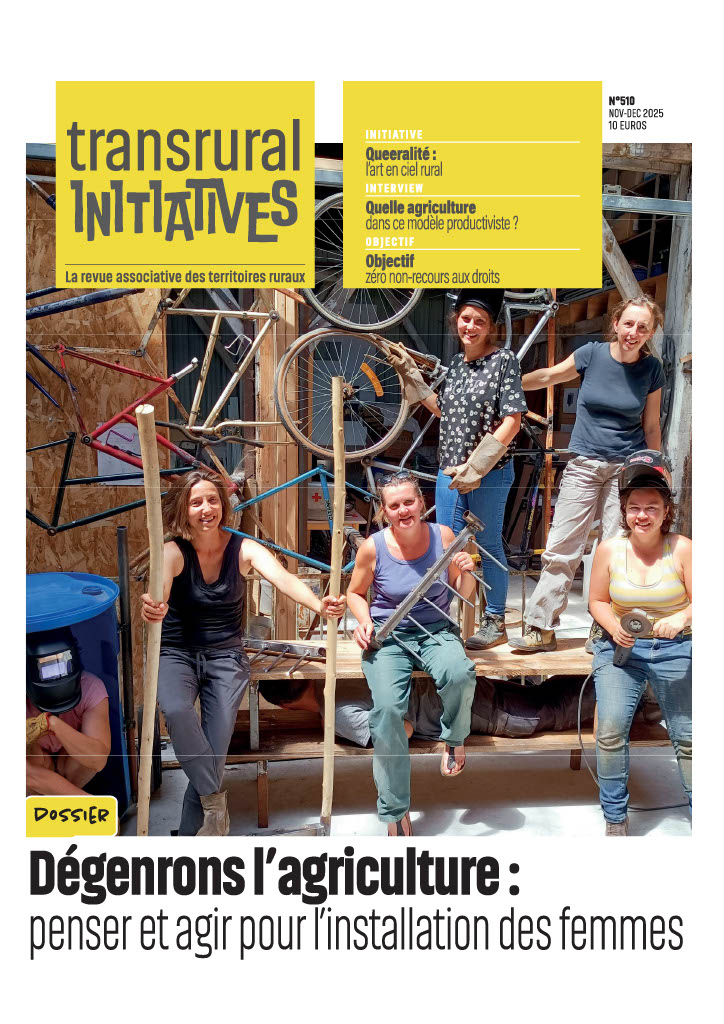
Pingback: Transrural initiatives n°506 – Sécurité sociale de l’alimentation : de la théorie à la pratique | Transrural initiatives ● La revue des territoires ruraux