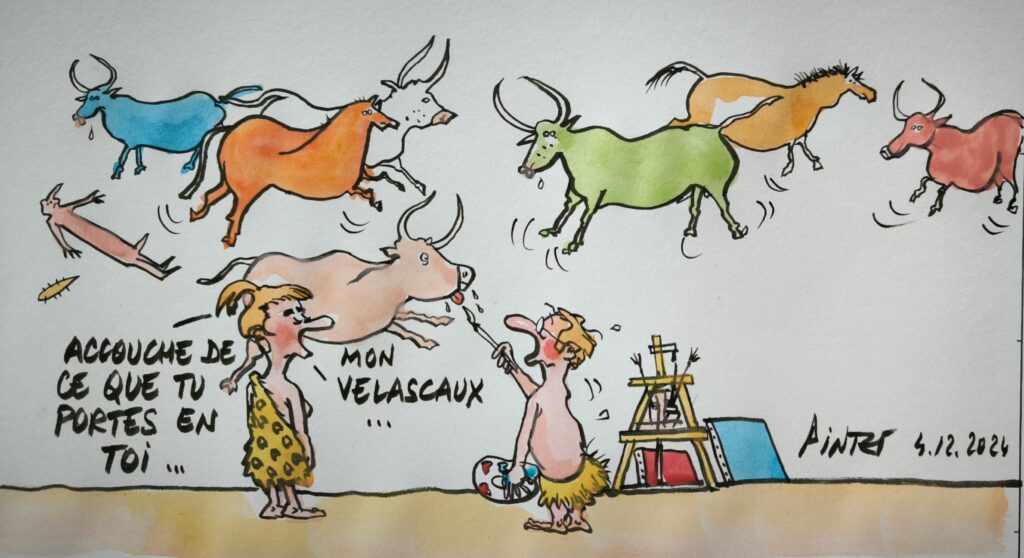1291 maternités ont fermé entre 1972 et 2021, entraînant une hausse des inégalités et une dégradation de la santé des femmes. État des lieux.

Dans quelles conditions les femmes du milieu rural et les coparents peuvent-ils développer leur projet d’enfant en sécurité : grossesse, accouchement, petite enfance, en incluant les répercussions de ce projet sur leur sécurité affective et sociale, leur santé, leur emploi et leur habitat ? Un constat s’impose : depuis les années 1970, les services publics se sont retirés d’un espace de vie qui regroupe 88 % des communes, un tiers des Français métropolitains et 11 millions de femmes dont 4 millions dans les zones isolées et moins peuplées. L’offre de soins s’est raréfiée : peu de médecins généralistes, de gynécologues, d’anesthésistes, de centres de santé… Cet abandon a des répercussions graves sur la santé des populations rurales. Plus touchées que les hommes dans les domaines de la santé et de la formation, les femmes portent la charge mentale, physique et financière de ce retirement irresponsable. En ne favorisant pas leurs accès aux soins de proximité basiques, l’état les expose à des violences dans la sphère publique et privée : 50 % des victimes de violences conjugales et 47 % des féminicides concernent les femmes du milieu rural, dont 26 % seulement sollicitent les dispositifs ad hoc.
Continue reading