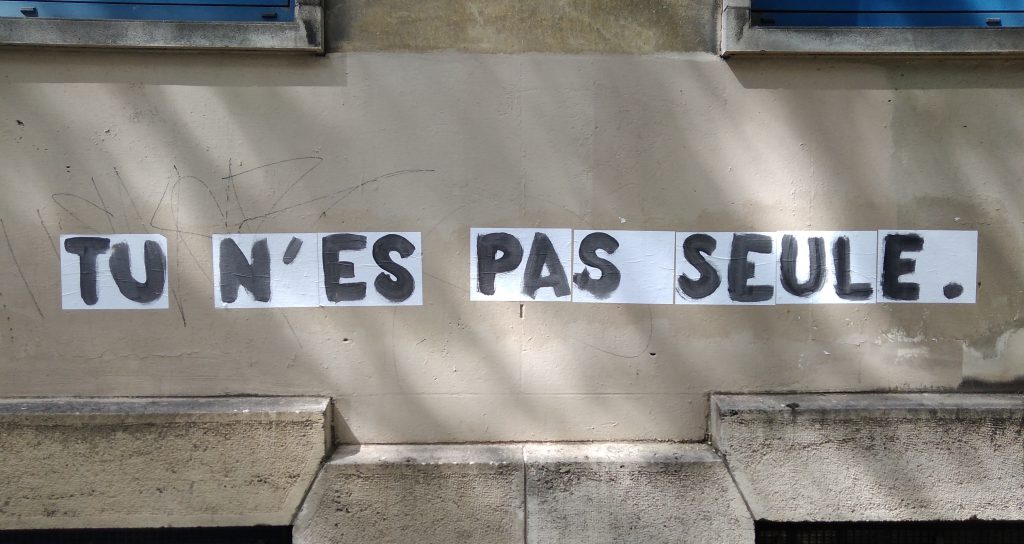Des citoyens et structures locales de Haute-Loire cherchent à concrétiser un lieu regroupant une matériauthèque, une outilthèque, une ressourcerie et divers ateliers et espaces pour cuisiner, fabriquer, réparer, se réunir…

En 2022, des structures locales et des citoyens, regroupés autour de l’envie de créer un lieu où se partagent savoir-faire, écologie et éducation populaire, ont fondé l’association L’étoile. L’objectif ? Créer en Haute-Loire un lieu hybride regroupant une matériauthèque, une outilthèque, une ressourcerie (vêtements, vélos, objets divers), des ateliers pour apprendre à fabriquer et réparer (bois, numérique, vélos), une cuisine avec restaurant pour des projets de cantine solidaire, ainsi que des salles d’activités, de réunion et des bureaux. L’idée est dans les esprits depuis 2014. Un voyage d’étude est organisé avec un réseau d’éco-artisans de la région et l’association Dasa (1) , basée à Brioude (42), qui accompagne les particuliers dans leurs projets de construction ou de rénovation. La visite de la matériauthèque de Saint-Pierre-des-Corps, en Touraine, est un déclic.
Continue reading