Léo Coutellec, paysan et philosophe, vient de publier un essai intitulé Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice1. Il revient sur l’intérêt d’une approche philosophique pour penser et agir, notamment contre la récupération politique et mercantile d’un paysan idéalisé : « Alors que nous sommes au bord du précipice écologique et social, sous quelles conditions peut-on penser des devenirs paysans pour nos sociétés » propose son éditeur.
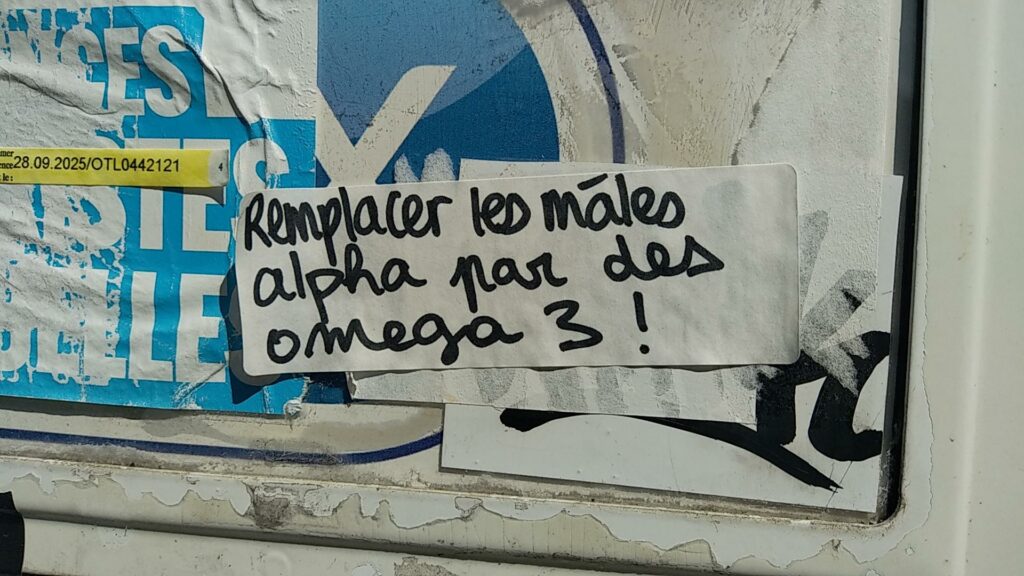
Peux-tu te présenter ?
Je suis paysan en Côte d’Or à Mâlain, installé depuis trois ans dans le cadre d’une dynamique collective qui a fêté ses dix ans. La ferme est partie prenante d’un tiers-lieu nourricier au sein duquel coopèrent d’autres producteur·rices, une foncière citoyenne, un café associatif, une épicerie coopérative et beaucoup d’évènements agriculturels2. Je suis impliqué dans la co-animation de ce tiers-lieu, notamment au sein de la Scic Ferments communs, une coopérative « agriculturelle » 3 qui réunit tous les acteur·ices de cet écosystème. Mon ancrage sur Mâlain s’inscrit dans la continuité d’un engagement de vingt ans pour l’agriculture paysanne, notamment dans le mouvement des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) que j’ai rencontré en 2003 à Lyon. Parallèlement, je continue de faire de la recherche et donner quelques enseignements en philosophie. L’écriture de cet essai, c’est un peu la rencontre de ces deux mondes.
Pourquoi avoir publié ce livre, avec quelle intention ?
Je crois qu’il y avait d’abord l’envie de partager mes réflexions et vécus sur la paysannerie, avec le double regard du praticien et du philosophe, pour prendre du recul personnellement mais aussi pour contribuer à penser ce que nous sommes en train d’expérimenter dans ces interstices du système productiviste-consumériste. C’est essentiel de penser nos pratiques, y compris de façon critique, mais aussi d’ouvrir la possibilité que nos pensées soient bousculées par nos pratiques. C’est un projet qui traînait un peu et il a fallu un déclencheur. La lecture du livre de Michel Onfray, co-écrit avec la présidente de la Coordination rurale (CR), qui s’appelle Entendez-vous dans vos campagnes4, m’a permis de mesurer l’ampleur de l’offensive culturelle d’une vision rance de la paysannerie. À peu près au même moment, début 2025, on avait les résultats des élections des chambres d’agriculture, qui a vu une percée historique de la CR. Je me suis vraiment dit qu’on était à un point de bascule, une forme de retour en arrière des années 1930, où sévissait une forme de fascisme rural. Le contexte est très différent mais les mots, les méthodes et les horizons sont les mêmes. Un élan réactionnaire et conservateur, une volonté sécessionniste, une exacerbation du corporatisme, auxquels s’ajoute un « pétro-masculisme » débridé avec ces manifestations de gros tracteurs où la démonstration viriliste et machiniste se conjuguent. Que la philosophie soit mise au service de ce projet, ça m’a un peu mis en colère !
Tu parles de l’idée de lutter, notamment « contre la récupération politique et mercantile d’un paysan idéalisé » ?
Oui, c’est l’idée de sortir de ce récit qui a capturé la figure du paysan, à la fois conservateur et réactionnaire d’un côté, et modernisateur de l’autre. Les deux vont ensemble, cohabitent, coopèrent. C’est toute l’histoire de la FNSEA, qui est de jouer sur les valeurs morales d’une vision rétrograde de la paysannerie tout en asservissant celle-ci à l’économie modernisatrice et capitaliste de l’agro-industrie. Quand on pense à la marque Paysan breton ou aux chips paysannes, c’est l’agro-industrie la plus débridée au service du profit des acteurs de l’agro-alimentaire qui utilise la figure idéalisée du paysan comme un argument marketing.
Il s’agit donc de se réapproprier ce concept de paysan ? La récupération ou les limites d’un concept n’implique pas obligatoirement de l’abandonner, comme le suggèrent ou le proposent d’autres auteurs5. Au contraire, il y a de la place pour se réapproprier un nouveau récit, un nouvel imaginaire, une nouvelle culture de l’agriculture. C’est un combat à mener. Depuis 20 ans, je baigne dans la paysannerie, avec des paysannes et paysans, ce sont des réalités très concrètes, ce sont des femmes et des hommes, des fermes, des collectifs, des essais, des expérimentations. Abandonner le mot « paysan », c’est comme nier cette réalité partagée par des milliers de personnes quotidiennement. Il faut plutôt partir de cette réalité, la comprendre, la valoriser, la visibiliser et l’inscrire dans ce mouvement de transformation culturelle vers une paysannerie émancipatrice.
Dans le livre, tu t’intéresses à plusieurs mots qui peuvent poser problème comme le local, la résilience, l’attachement identitaire… il y a donc un enjeu derrière les mots que l’on utilise ?
Derrière ces mots, ce que j’ai essayé de travailler, c’est surtout des concepts : en philosophie, c’est notre matériau de base. On peut parfois choisir de les abandonner parce qu’irrécupérables, mais souvent on cherche à les transformer, à leur donner un autre sens, à les enrichir. Je propose par exemple d’abandonner le concept de localisme au profit de celui de proximité, plus à même de décrire le type de relation que l’on cherche à construire. J’essaye aussi de parer des pièges du langage comme l’usage trop fréquent de l’expression « bon sens paysan », l’arme de celles et ceux qui ne veulent pas justifier leurs actes. De même, quand on dit que l’agriculture paysanne, ne suffira pas à sortir nos pensées, nos imaginaires, nos pratiques de l’emprise productiviste-consumériste. Bien sûr, nous avons besoin de ces changements institutionnels et sociaux, je reste convaincu de la puissance de la formule de Marx selon qui « ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience ».
Mais Marx écrit aussi, un peu plus tard dans L’Idéologie allemande, que « la production des idées, des représentations et de la conscience, est d’abord directement et intimement mêlées à l’activité matérielle (…) elle est le langage de la vie réelle ». Il ne s’agit donc pas tant de changer nos pratiques par les idées mais de transformer ensemble nos pratiques et ce qui les accompagne inévitablement dans le domaine de l’esprit. C’est pour ça que je me revendique d’une philosophie depuis l’agriculture et non pas de l’agriculture.
Quand on crée un groupement foncier agricole citoyen, comme on l’a fait il y a dix ans à Mâlain, c’est à la fois un changement matériel et culturel. On crée une nouvelle institution, une nouvelle forme d’organisation tout en sortant nos imaginaires du patrimonialisme capitalistique. On dissocie la propriété de l’usage et l’un comme l’autre deviennent des enjeux de démocratie alimentaire. Souvent on cherche des solutions techniques à nos problèmes : il faut changer nos modes de production, s’équiper d’un nouvel outil… Mais si tu n’as pas fait un travail pour questionner les changements dans ta vie de tous les jours, si tu n’accompagnes pas ça d’une réflexion politique sur ce que ces changements nécessitent, notre façon d’utiliser les outils, de faire de l’économie, d’être en relation avec des non-paysans, tu risques de ne pas comprendre la nature du problème et de reproduire des schémas dominants. Tu te retrouves à travailler plus de 60 heures par semaine, à t’épuiser et à perdre le sens de ce que tu fais. L’agriculture paysanne peut être une aliénation si elle n’est pas pensée comme une pratique émancipatrice.
Après avoir décrit « ce qui nous limite » tu évoques plusieurs horizons désirables. Quelles seraient les pistes à retenir dans le chapitre sur « ce qui nous fait espérer » ?
Si cet essai est assez critique sur la situation de l’agriculture aujourd’hui, il cherche à montrer que des devenirs paysans désirables sont possibles. La première idée qui me tient à cœur est le renouvellement de l’alliance entre la paysannerie et la société, qui s’est intensifiée ces 20 dernières années. La paysannerie doit redevenir une préoccupation publique, citoyenne et politique. Cette alliance entre une paysannerie émancipée et une société civile consciente, c’est la base. Je suis un fervent défenseur de toutes les expérimentations locales qui visent à renforcer cette alliance, contre le corporatisme. Mais cela devrait aussi passer par des politiques structurantes.
Je pense notamment à la sécurité sociale de l’alimentation (SSA) qui pourrait marquer un vrai changement de paradigme dans notre façon de penser la place de l’alimentation en société. Mais cela n’impliquera pas automatiquement un changement dans notre façon de penser la paysannerie si la SSA se réduit à créer une opportunité économique nouvelle pour les paysans. Il faut aussi réfléchir à la condition sociale des travailleuses et travailleurs de la terre, à la façon de s’organiser, à nos modèles économiques. C’est un travail que la Confédération paysanne mène. Par exemple, je trouve très insatisfaisante l’alternative entre le statut de « chef d’exploitation » et celui de salarié subordonné. Cet état de fait, dans lequel la corporation agricole dominante nous enferme depuis des décennies, nous pouvons la dépasser avec une visée émancipatrice. En ce sens, il y a quelque chose de désirable dans le modèle des sociétés coopératives de production (Scop) agricoles et plus largement dans l’idée d’expérimenter une forme de salariat paysan coopératif.
Aurais-tu un passage de ton livre que tu aimerais partager ?
Oui, celui-ci résume bien l’état d’esprit avec lequel j’ai écrit cet essai, c’est dans le premier chapitre : « Parfois, en combattant le “système” nous lui fournissons du carburant, en expérimentant des pas de côté, nous lui donnons de l’inspiration, voire même une justification, en utilisant ses mots nous le renforçons culturellement. Se sentir coresponsable, c’est faire porter la critique par un travail rigoureux sur nos pratiques, nos mots, nos concepts, nos imaginaires, et évaluer en quoi ils entretiennent le monstre plutôt que de nourrir ce qui pourrait le faire tomber. Penser au bord du précipice, c’est donc se situer entre espérance et responsabilité, lier l’utopie (nos espérances) aux possibilités concrètes de sa réalisation (nos responsabilités). Car une espérance sans responsabilité ne reste qu’une promesse mais la responsabilité sans espérance nourrit la résignation. »
Propos recueillis par Fabrice Bugnot (Transrural)
1 – Le Bord de l’eau. Octobre 2025. 192 pages
2 – À l’instar du Festival Atout bout d’champ autour des alternatives agricoles, alimentaires et écologiques qui a lieu tous les deux ans depuis 2017.
3- www.alternatives-agriculturelles.fr
4 – On y lit par exemple : « Le monde agricole est le dernier bastion du monde traditionnel au sens noble et vrai du terme… » ou « Nous sommes les rares, voire les seuls à rester enracinés ».
5 – Par exemple : Edouard Morena. Paysan, Anamosa, 2024 conscience
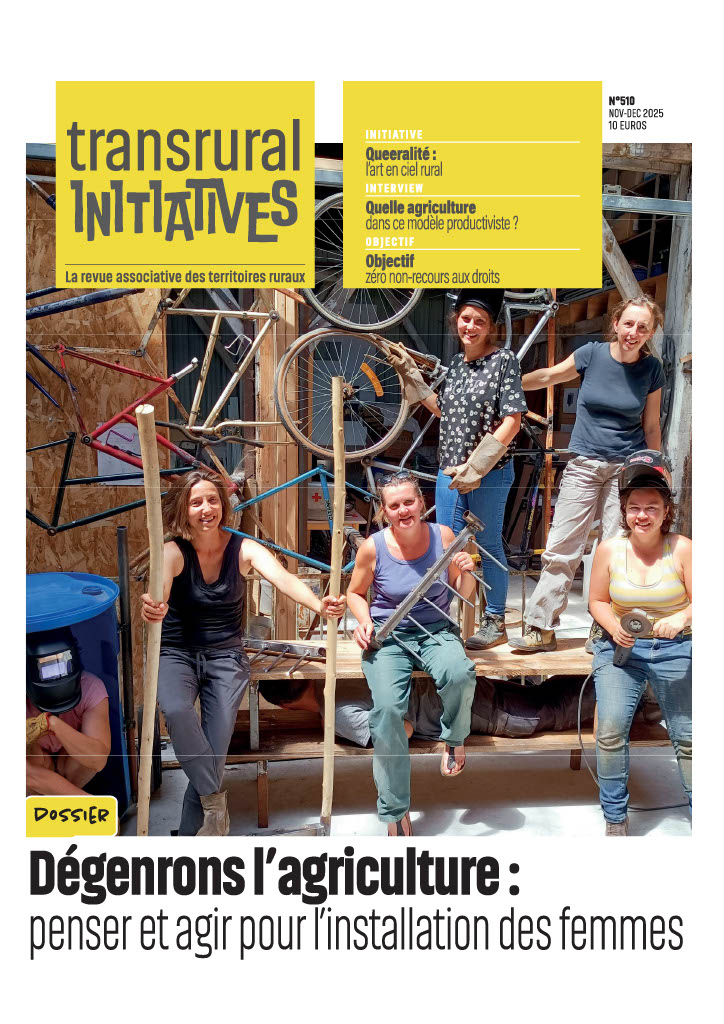
Pingback: Transrural initiatives n°508 – Faire la fête et faire village | Transrural initiatives ● La revue des territoires ruraux